Bienvenue sur cette petite fiche introductive au sujet de la littérature du surnaturel !
Fantasy, fantastique, dystopie, science-fiction, quelles différences ? Comment distinguer ces différentes littératures du surnaturel ? Quels sont leurs visées, leurs constructions ?
Et d’ailleurs : qu’est-ce le surnaturel, au juste ? Ne se limite-t-il qu’à la magie et à l’étrangeté ? Savez-vous d’ailleurs qu’il existe des théories sur la littérature fantastique ? La plus célèbre est celle de Tzevan Todorov, avec son Introduction à la littérature fantastique.
Vous trouverez sans doute quelques réponses dans cette petite fiche ! J’espère qu’elle parviendra à éclairer certains points. Si elle vous plaît, n’hésitez d’ailleurs pas à la partager et à laisser vos impressions !
QU’EST-CE QUE LE SURNATUREL ?
Avant de nous attaquer à ce qui distingue les différents genres du surnaturel, commençons d’abord par un petit rappel sur ce qu’est le surnaturel.
Le surnaturel peut se définir comme l’intervention d’un phénomène qui ne relève pas des lois terrestres et d’un système de pensée rationnel.
De cette définition découle plusieurs idées :
- celle d’un pouvoir transcendantal qui relève du sacré, des Dieux et des mois divines ;
- celle de l’existence d’êtres supérieurs aux hommes.
- celle de l’existence d’un phénomène qui ne semble pas appartenir au monde tel que nous le connaissons.
- celle de l’existence de technologies ou d’une science supérieure à celle que nous connaissons,
- celle de l’existence d’un phénomène qui n’est pas compris dans la nature biologique de l’homme.
Le CNRTL (centre national de ressources textuelles et lexicales) donne l’exemple du crime, originellement naturel car ancré dans nos instincts primaires, et de la vertu, artificielle puisqu’héritée de la construction sociale. Cet exemple est à adapter, bien évidemment, dans le cas d’une littérature du surnaturel (par exemple, la mortalité et l’immortalité).
Ainsi, quelque soit l’origine du surnaturel, cette notion est toujours liée à l’intervention d’un phénomène qui nous dépasse en tant que lecteur. Cela englobe aussi bien les mythes et les légendes que la magie ou l’émergence d’un nouveau système politique…
La littérature du surnaturel se concentre avant tout sur un décalage entre notre expérience de la réalité en tant que lecteur externe, et celle des personnages du romans, internes à une œuvre.
En effet, la réalité que nous connaissons n’est pas toujours la même que celle du roman, et c’est cette différence qui engendre le surnaturel pour nous.
Il s’agit tout simplement de l’émergence d’un phénomène de pensées ou d’un phénomène physique qui semble de premier abord impossible à concevoir, ou presque. C’est pour cela que le surnaturel est un genre littéraire qui regorge de possibilités, et de formes multiples pour s’exprimer.
LES GENRES DU SURNATUREL
Dans la littérature du surnaturel, nous distinguons plusieurs genres qui s’y rattachent, dont voici les principaux ; la fantasy, le fantastique, le merveilleux, la dystopie et la science-fiction.
Eux-mêmes sont parfois divisés en de nombreux sous-genres – par exemple, l’urban-fantasy, l’heroic-fantasy pour la fantasy, etc.
Avec tous ces genres littéraires, il n’est parfois pas évident de nous y retrouver sans s’emmêler les pinceaux. De loin, il est facile de confondre ces différents genres, pourtant, chacun d’entre eux possède des codes et des caractéristiques bien précises pour les identifier plus facilement.
Chacun de ces genres revendiquent d’ailleurs une utilisation bien spécifique, une certaine forme d’intervention du surnaturel plutôt qu’une autre.
Voici quelques définitions simplifiées pour vous aider à vous y retrouver.
DEFINITIONS DE GENRES – MERVEILLEUX, FANTASY, FANTASTIQUE.
Merveilleux : décrit un univers où le surnaturel est totalement accepté, à la fois par le narrateur, lecteur et les personnages, et se mélange à notre réalité. Sans être la norme, le surnaturel ne suscite pas de méfiance ni de surprise. Il s’agit principalement du genre des contes de fées, et possède donc des personnages stéréotypées et un schéma narratif relativement simple, ancré dans notre monde et à la temporalité et la spatialité vagues.
Fantasy ; décrit un univers qui est différent du nôtre. Dans la fantasy, le surnaturel n’est pas sources d’angoisses ou de surprises ; il s’agit souvent d’une norme qui permet à l’auteur(e) de définir les fondements de son univers et de le construire.
Fantastique : décrit un univers qui correspond au nôtre sans l’être tout à fait. Contrairement à la fantasy, ici, le surnaturel n’est pas la norme et suscite généralement de la part du commun des personnages de l’incompréhension, de la méfiance, voire de la peur.
C’est avant tout la notion de norme que vous devez privilégier pour déterminer si un roman appartient au genre du merveilleux, de la fantasy ou du fantastique. Attention également à ne pas confondre la notion d’univers (= l’ensemble de ce qui caractérise l’œuvre, que ce soit des coutumes, des légendes, de la magie) avec celui de monde (= le lieu où se déroule l’histoire) !
En effet, Harry Potter, par exemple, se passe dans notre monde, mais son univers est très différent. De même pour Percy Jackson, dont l’intrigue se déroule principalement à New York mais qui utilise l’univers de la mythologie grecque. Ainsi, même si ces deux sagas se déroulent dans le monde mortel tel que nous le connaissons, elle appartiennent bien au genre de la fantasy, puisque la magie est la norme pour le commun des personnages, bien qu’il ait un effet de surprises chez les deux protagonistes quand l’existence de leurs pouvoirs leur est révélée.
Ce sont souvent dans ces genres littéraires que nous retrouvons l’utilisation de la magie, des créatures mystiques et de la mythologie, entre autres.
TZEVAN TODOROV ET LA THEORIE DU FANTASTIQUE.
Dans son Introduction à la littérature du fantastique, Tzevan Todorov (1939 – 2017), essayiste français d’origine bulgare, distingue ainsi le fantastique du merveilleux, et par extension de la fantasy, par cette notion d’acceptation.
C’est d’ailleurs à cause de l’hésitation induite dans le fantastique que Todorov réfute l’utilisation de la poésie et de l’allégorie dans le récit fictif. La poésie, comme l’allégorie, renvoient en effet à des visions différentes du monde réel, que ce soit à travers un travail de sonorité et de rythme pour la poésie, ou par l’introduction d’une morale dans l’allégorie.
Il établit ainsi une liste de caractéristiques du discours fantastique, ainsi qu’une typologie des thèmes du fantastiques liés à l’utilisation du « je » – dont la métamorphose (La Métamorphose de Franz Kafka en est un très bon exemple), l’existence d’êtres surnaturels, le pan-déterminisme (= tout doit avoir une cause et le surnaturel peut l’expliquer) – et du « tu » – la sexualité notamment.
Todorov s’intéresse surtout à la question Pourquoi le fantastique ?, considérant d’abord qu’il permet de repousser les limites de l’esprit et d’abord des sujets interdits. C’est notamment un moyen de contourner et d’éviter la censure – l’intervention du diable, particulièrement, permet de mieux accepter ces tabous, et mêmes de les transgresser. Le fantastique est également un moyen détourné d’étudier et de comprendre la psychologie et ses troubles – encore une fois, la Métamorphose est un parfait exemple des troubles dont était atteint Kafka, l’auteur.
DEFINITIONS DE GENRES – SCIENCE-FICTION ET DYSTOPIE.
Science-Fiction ; décrit un univers qui se fonde sur les avancées technologiques, scientifiques, etc., le plus souvent dans le futur ou dans un espace-temps qui est différent du notre, mais également dans notre monde actuel. Pas de magie dans ce genre, mais un rapport aux sciences différents de l’époque du récit.
Dystopie : décrit un univers et une société régie par un régime politique et social – où le bonheur est impossible. La dystopie peut également se dérouler dans un univers post-apocalyptique. Dans ces récits fictifs, les citoyens sont entravés et ne sont pas libres, qu’ils en aient conscience ou non, tant physiquement que moralement. La dystopie n’est pas à confondre avec la contre-utopie, qui se base sur des principes vertueux mais dont la réalisation est indésirable.
Contrairement au merveilleux, à la fantasy et au fantastique, la science-fiction et la dystopie privilégient plutôt les avancées technologiques et sociales pour construire leur univers. Leur but est de souligner les dérives de notre monde et de réfléchir à leurs conséquences.
La science-fiction et la dystopie sont généralement plus ancrés dans notre monde – mais peuvent prendre corps dans un monde tout à fait différents du notre ! (Star Wars, par exemple). Ils interrogent surtout l’avenir et le monde de demain à travers le surnaturel et les constructions sociales et politiques.
EXEMPLES DE ROMANS ET DE FILMS
Merveilleux :
La Belle et la Bête, Gabrielle-Suzanne de Villeneuve, (1740)
La Belle au Bois Dormant, Charles Perrault (1687), Frères Grimm (1812)
Cendrillon, Charles Perrault, Frères Grimm, etc.
La Petite Sirène, Hans Christian Andersen, (1837)
Raiponce, Frères Grimm, (1812)
Hansel et Gretel, Frères Grimm, (1812)
Le Petit Poucet, Charles Perrault, (1697)
Nain Tracassin, Frères Grimm, (1812)
Fantasy :
Harry Potter, J.K. Rowling, (1997 – 2007)
Percy Jackson, Rick Riordan, (2005 – 2010)
Le Seigneur des Anneaux, J. R. R. Tolkien, (1954 – 1955)
L’Epée de Vérité, Terry Goodkind, (1994 – 2015)
Les Chevaliers d’Emeraude, Anne Robillard, (2003, 2008)
Les Archives de Roshar, Brandon Sanderson, (2010 – 2020)
L’Assassin Royal, (1995 – 1997) ; Les Cités des Anciens (2009 – 2013), Robin Hobb
La Roue du Temps, Robert Jordan, (1990 – 2013)
La Passe-Miroir, Christelle Dabos, (2013 – 2019)
Le Trône de Fer, G. R. R. Martin, (1996 – )
Fantastique :
Le Château d’Ortante, Horace Walpole, (1764)
Les Mystères d’Udolphe, Ann Radcliff, (1795)
Le Horla, Guy de Maupassant (1886)
La Métamorphose, Franz Kafka (1915)
Le Diable Amoureux, Jacque Cazotte, (1772)
La Vénus d’Ille, Prosper Mérimée, (1837)
La Peau de Chagrin, Honoré de Balzac, (1831)
Science-Fiction :
Le Guide du Voyageur Galactique (H2G2), Douglas Adams, (1978)
La Machine à Explorer dans le Temps, H. G. Wells, (1895)
Histoire comique des Etats et Empires du Soleil et de la Lune, Savinien de Cyrano de Bergerac, (1665 – 1662)
Cycle de Dune, Frank Herbert, (1965 – 1985)
La Planète des Singes, Pierre Boulle, (1963)
Marvel et DC Comics
Star Wars, George Lucas, (1977 – )
Star Trek, Gene Roddenbury, (1966 -)
(Ready) Player One, Ernest Cline, (2011), Steven Spielberg (2018)
Je suis une légende, Richard Matheson, (1954)
Inception, Christopher Nolan, (2010)
Les Gardiens de la Galaxie, James Gunn, (2014), adapté de la série de comics du même nom.
Retour vers le Futur, Robert Zemeckis, (1985 – 1990)
Dystopie :
1984, George Orwell, (1948)
Fahrenheit 451, Ray Bradbury, (1953)
Le Meilleur des Mondes, Aldous Huxley, (1931)
La Servante Ecarlate, Margaret Atwood, (1985)
Le Pouvoir, Naomi Alderman, (2016)
Orange Mécanique, Stanley Kubrick, (1971)
Le Talon de Fer, Jack London, (1908)








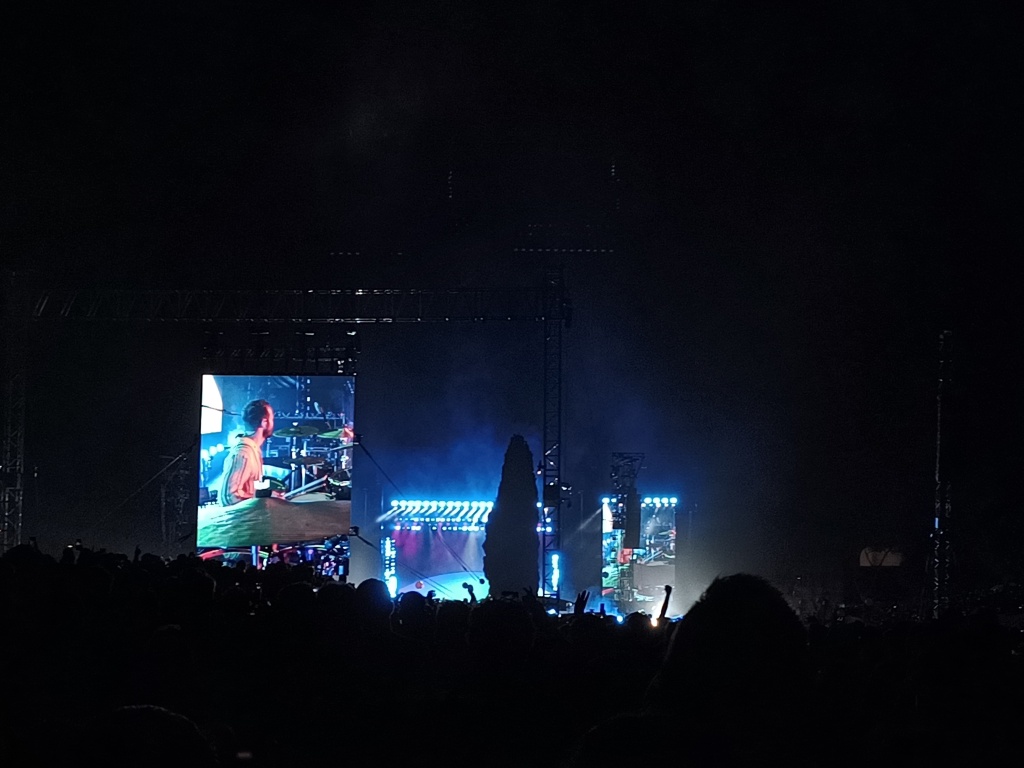
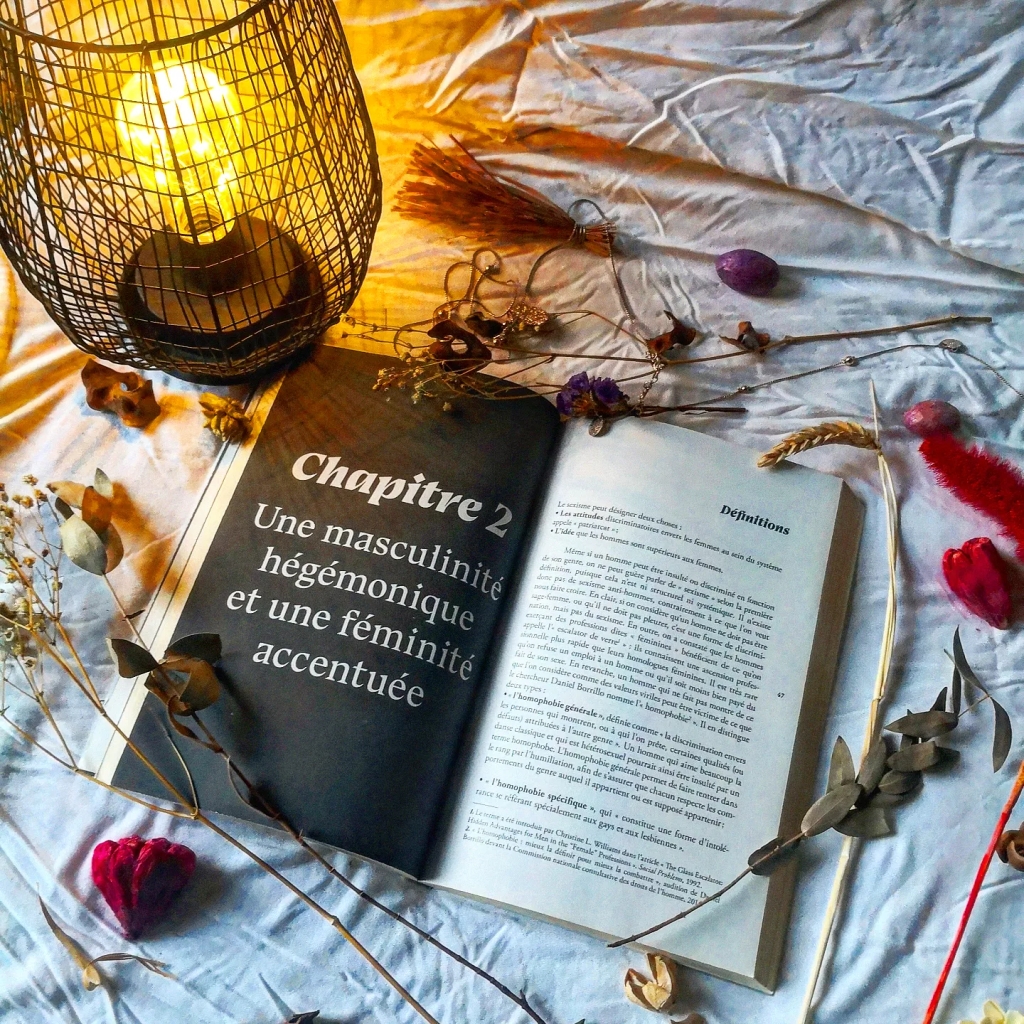


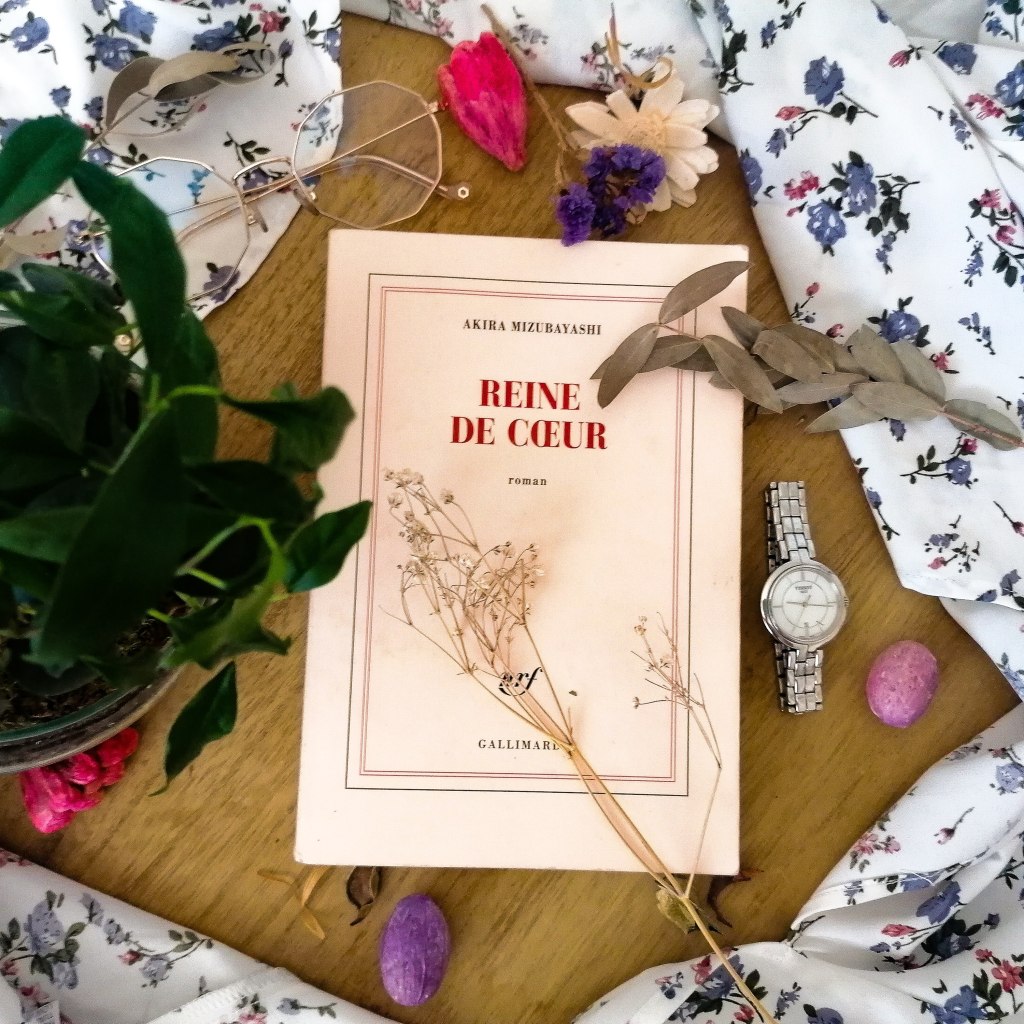

Laisser un commentaire